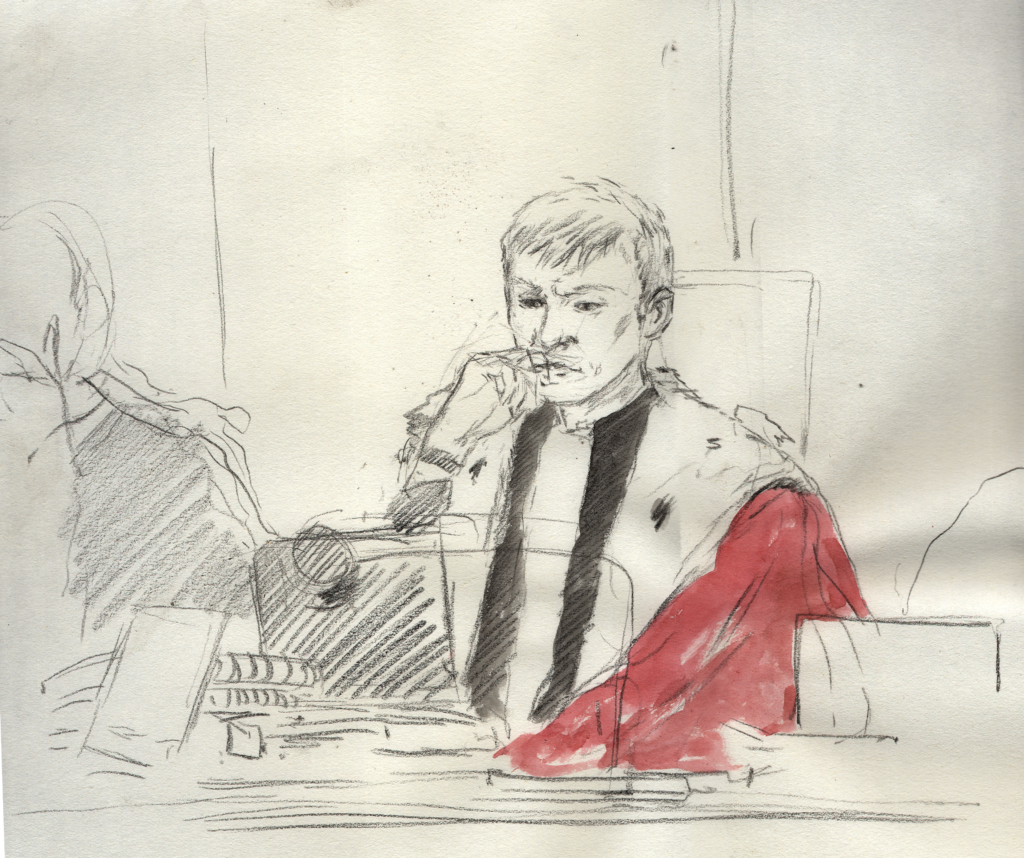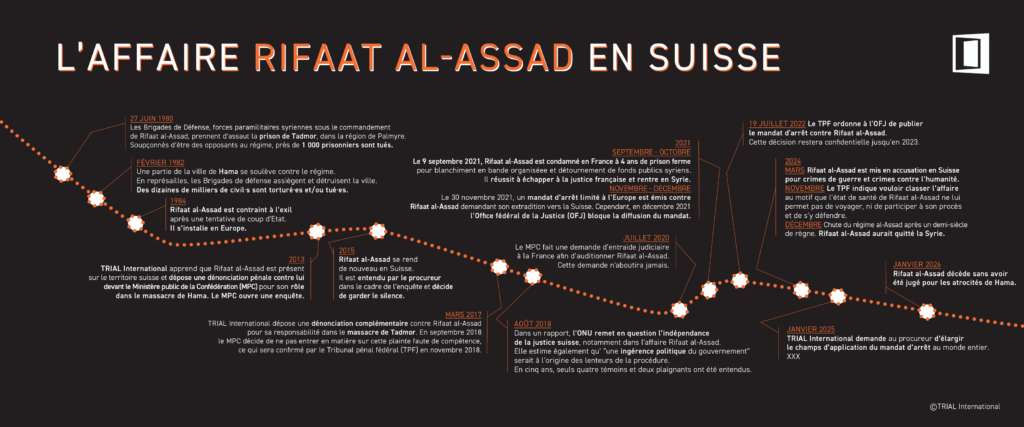Une police pour les crimes de guerre : en Suisse aussi ?
Plusieurs pays ont instauré des unités spécialisées dans la recherche et la poursuite des criminels internationaux. Les résultats sont là. Pourquoi pas la Suisse ? A l’heure où le Conseil fédéral s’apprête (enfin!) à renvoyer cette année un projet de loi au Parlement visant à introduire l’ensemble des crimes prévus par le Statut de la CPI en droit interne, TRIAL est d’avis que la Suisse devrait y réfléchir sérieusement. L’efficacité de la poursuite des criminels internationaux aurait tout à y gagner.
Pour certains crimes (génocide, crimes de guerre ou contre l’humanité, torture), les autorités nationales ont la possibilité de mener à bien des poursuites même lorsque le crime a été commis à l’étranger, par un étranger, contre un étranger. C’est ce qu’on appelle la compétence universelle. Plusieurs affaires ont, sur cette base, récemment abouti à des jugements dans des pays comme la Suisse, le Royaume-Uni, le Danemark, la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas ou encore la France, notamment. Ces procédures sont toutefois compliquées et se heurtent à de nombreux obstacles.
Principalement, on mentionnera le manque d’expérience de la part d’autorités nationales plutôt habituées à s’occuper d’infractions domestiques. Les procédures de compétence universelle peuvent sembler intimidantes et onéreuses. Se posent des problèmes liés au caractère international de l’enquête, à la nécessité d’une coopération interétatique, à la barrière de la langue, au besoin de comprendre le contexte historique et politique dans lequel le crime présumé a été commis, la récolte des preuves, les témoins qui ne sont pas nécessairement à disposition.

Néanmoins, dans plusieurs pays, malgré ces difficultés, des affaires ont été menées à terme. De tels développements ont généralement eu lieu dans des pays ou les autorités judiciaires se sont organisées pour traiter de manière sérieuse et systématique les dossiers pouvant relever de la compétence universelle. Car ceux-ci sont potentiellement plus nombreux qu’on ne le croit.
Nombreux cas en Europe
Dans une décision du 8 mai 2003, le Conseil de l’Union Européenne observait ainsi que «les États membres sont régulièrement confrontés à des personnes qui ont été impliquées dans ce type de crimes et qui cherchent à entrer et à résider dans l’Union européenne». A titre d’exemple, un journal britannique titrait au début janvier 2007 que plus de 50 criminels de guerre présumés se trouvaient en Grande-Bretagne (4 Rwandais ont d’ailleurs été arrêtés il y a quelques semaines). Certains pays ont alors répondu à ce défi en créant des unités spéciales au sein des autorités policières et judiciaires, spécialisées dans l’enquête et la poursuite des crimes internationaux, incluant les affaires de compétence universelle. De telles unités spécialisées permettent de renforcer l’efficacité et les compétences au sein d’une même équipe en concentrant l’expérience et l’information sur l’enquête et la poursuite des ces crimes.
La majorité des affaires de compétence universelle qui ont été jugées en Belgique, dans les Pays-Bas, au Danemark et en Grande Bretagne impliquaient des auteurs de crimes qui étaient entrés dans ces pays en tant que requérants d’asile. Il arrive alors parfois que ces individus soient reconnus et dénoncés par des compatriotes. Mais il arrive aussi que ce soit sur la base des informations livrées par le requérant dans le cadre de sa demande d’asile que l’on arrive à savoir qu’il a été impliqué dans la commission de crimes sérieux.
A cet égard, on faut ici souligner que l’article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés énonce que les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité se verront retirer la protection de la Convention de 1951. Ces faits doivent donc être tirés au clair par les autorités d’asile. Dès lors, celles-ci peuvent jouer un rôle extrêmement important en alertant la police ou les autorités judiciaires de la présence d’un auteur de crimes internationaux présumé sur le territoire national.
«War crimes units»
Au Danemark, en Norvège et dans les Pays-Bas, les autorités d’immigration ont créé un département spécialisé dans la révision des candidatures d’asile et de visa qui contiennent des informations suggérant une participation à des crimes internationaux. Une liste de suspects est par exemple dressée sur la base de certains critères et comparée avec les listes de suspects en provenance des tribunaux internationaux. Cette approche est si essentielle à l’exercice de la compétence universelle dans ces trois pays que les autorités de poursuite pénale ont reçu la majorité de leurs affaires par les autorités de l’immigration.

Le service d’immigration et de naturalisation des Pays-Bas, par exemple, possède une unité spéciale qui traite uniquement des cas « 1F » douteux. Lorsqu’une demande est refusée sur la base d’une possible participation à un crime international, le dossier est alors transmis aux autorités judiciaires pour enquête approfondie.
Le Danemark a mis en place une unité composée de procureurs et d’enquêteurs, combinant ainsi les expertises juridiques et d’enquête. Ces deux formes d’expertises améliorent et accélèrent fortement la capacité de décision sur la nécessité d’enquêter dans des dossiers délicats. A noter également que le service d’immigration du Danemark travaille avec la croix rouge danoise en distribuant des papiers aux requérants d’asile leur expliquant où et auprès de qui ils peuvent déposer plainte s’ils ont été victimes d’un crime international ou s’ils ont connaissance de la présence de l’auteur d’un de ces crime au Danemark.
La Grande Bretagne aussi a récemment établit un bureau spécial au sein de son «Immigration and Nationality Directorate». Ce bureau est exclusivement en charge des allégations de crimes internationaux commis par des candidats au visa ou à l’asile.
La Belgique par contre ne possède pas formellement une équipe de juges enquêteurs, mais une unité spéciale de police. Cependant, de par le fait de l’augmentation rapide des plaintes déposées sur une base de compétence universelle, une poignée de juges belges ont peu à peu accumulé une expertise considérable dans ce type d’affaires.
Certains autres pays, comme la France et l’Espagne, ne possèdent pas encore d’unités spécialisées mais basent essentiellement leur compétence universelle sur le mécanisme de la constitution de partie civile. Cependant dans ces situations, les plaignants ne possèdent pas les ressources nécessaires aux enquêtes, ni l’expertise de la police, ni la capacité de bénéficier de la coopération d’un Etat tiers. Ainsi, comme l’explique Human Rights Watch, en se basant uniquement sur les parties privées dans l’enquête et la poursuite d’affaires reliées à la compétence universelle, ceci garantit que cette compétence universelle ne sera exercée que d’une manière ad hoc et intermittente.
Et la Suisse ?
Pour ce qui est de la Suisse, le 1er janvier 2008, un nouvel article 98a de la loi fédérale sur l’asile entrera en vigueur, dont la teneur est la suivante :
« L’office [fédéral des migrations] ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuites pénales compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d’avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture. »
A la connaissance de TRIAL, la transmission d’information entre les autorités d’asile et les organes de justice pénale ne fonctionne actuellement pas. Les affaires dans lesquels des motifs sérieux de croire que des crimes internationaux ont été commis aboutissent à des rejets de demande d’asile, mais pas à des enquêtes pénales. TRIAL a écrit aux autorités concernées (Office fédéral des migrations; Tribunal administratif fédéral; Ministère public de la Confédération ; Auditeur en chef de l’armée) en janvier 2007 pour leur rappeler que, avant même l’entrée en vigueur de l’art. 98a susmentionné, la Suisse avait une obligation de rechercher activement les auteurs de crimes de guerre, comme les Conventions de Genève l’énoncent d’ailleurs explicitement.
Le Ministère public de la Confédération a d’ailleurs répondu par courrier qu’il partageait ce point de vue. L’office fédéral des migrations a fait savoir par courrier du 16 février 2007 que sa pratique était effectivement de transmettre des telles affaires à la justice pénale. Le Tribunal administratif fédéral (l’autorité de recours en matière d’asile) n’a, à l’heure d’écrire ces lignes (21 février 2007), par encore répondu à cette interpellation.
Il reste à espérer que dans le cadre des discussions parlementaires qui devraient se tenir à fin 2007 sur le projet du Conseil fédéral d’introduire – enfin – l’ensemble des crimes prévus par le Statut de la CPI en droit interne, l’idée soit reprise de créer une telle unité spécialisée en Suisse.
En effet, les pays d’immigration font face au risque de devenir des zones protégées pour des auteurs de crimes internationaux, à moins de formaliser et renforcer les mécanismes de coopération et d’échange d’informations entre les autorités d’immigration et les autorités judiciaires. Les expériences hollandaise, norvégienne, danoise ou encore britannique suggèrent fortement que des unités spécialisées peuvent être très efficaces dans le criblage des demandes ainsi que dans la formation des officiers de l’immigration dans la détection de criminels internationaux.
Liens
- Danemark: Special International Crimes Office: www.sico.ankl.dk/page22.aspx
- Recours Juridiques pour les victimes de « crimes internationaux »: Favoriser une approche européenne de la compétence extraterritoriale, rapport de Redress et de la FIDH, mars 2004: www.fidh.org/article.php3?id_article=1563
- “Universal Jurisdiction in Europe The State of the Art”, Human Rights Watch, June 2006, disponible à http://hrw.org/reports/2006/ij0606/index.htm
- Décision 2003/335/JAI du Conseil de l’Union européenne du 8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre
- Affaires en Belgique (Trial Watch)
- Affaires au Danemark (Trial Watch)
- Affaires aux Pays-Bas (Trial Watch)
- Affaires en Grande-Bretagne (Trial Watch)
- Pour certaines des affaires ayant concerné la Suisse, voir ici.