La Cour supérieure de Podgorica a condamné aujourd’hui, après un procès de trois ans, Slobodan Peković à 20 ans de prison pour un crime de guerre contre des civils commis en 1992 en Bosnie-Herzégovine. Peković a été reconnu coupable du meurtre de deux civils, Emina et Mujo Šabanović, dans le village de Hum près de Foča, ainsi que du viol d’une personne de sexe féminin à l’identité protégée dans un appartement de Foča, qu’il a fait sortir de la tristement célèbre salle « Partizan ». Ce verdict constitue une avancée importante pour le système judiciaire monténégrin, car il s’agit du premier verdict pour violences sexuelles en temps de guerre et de la peine la plus sévère pour crimes de guerre depuis le verdict pour le meurtre des membres de la famille Klapuh en 1996. Ce verdict constitue une avancée significative dans la répression des crimes de guerre au Monténégro et pourrait encourager d’autres victimes à demander justice dans le cadre de procédures judiciaires.
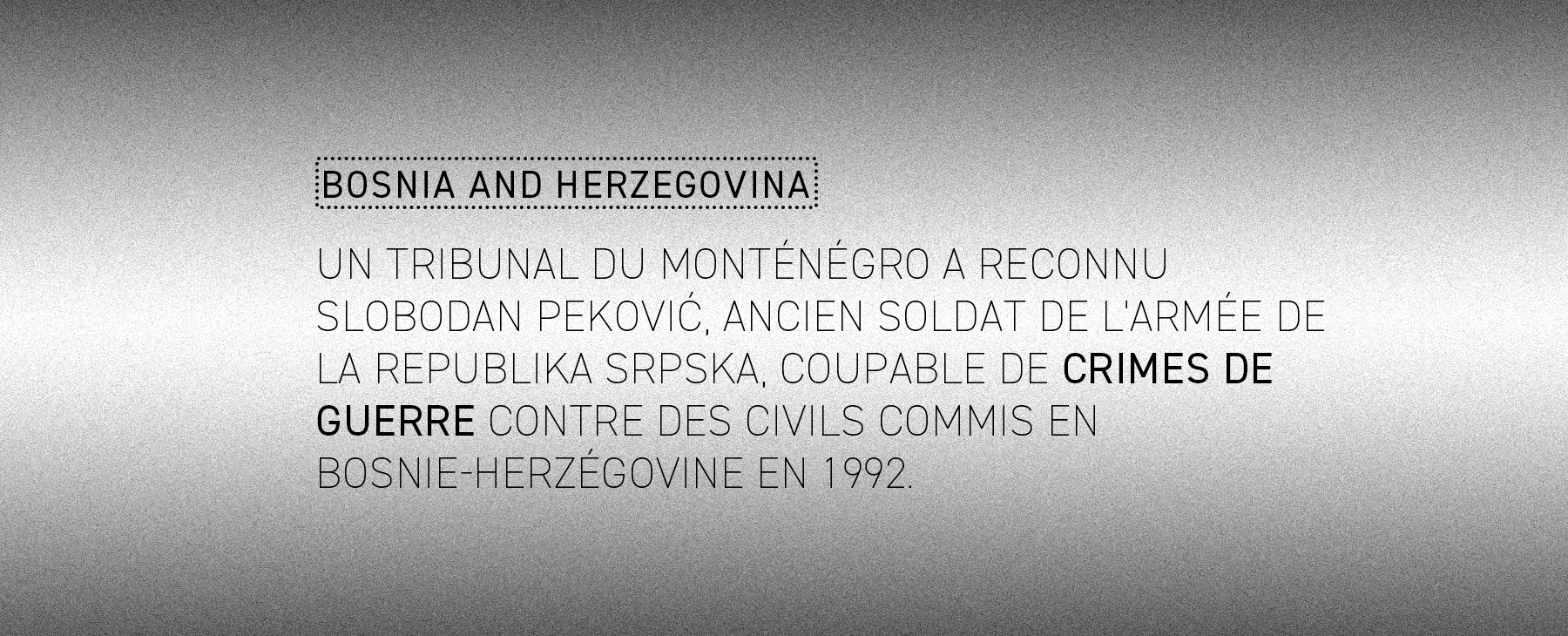
Le panel du procès était présidé par la juge Nada Rabrenović, tandis que les membres du panel étaient les juges Zoran Radović et Goran Šćepanović. L’acte d’accusation a été représenté par le procureur spécial Tanja Čolan Deretić.
Le verdict est un verdict de première instance et l’accusé a le droit de faire appel auprès de la Cour d’appel du Monténégro.
Slobodan Peković, dont l’ancien nom de famille était Ćurčić, a été reconnu coupable d’avoir participé à l’attaque du village de Hum, près de Foča, en juin 1992, en tant que membre de l’armée de la Republika Srpska. Ensuite, avec d’autres soldats, il a fait sortir Emina Šabanović de sa maison, en la frappant sur tout le corps avec une pelle et en la traînant par les cheveux, et l’a emmenée dans la maison de Mujo Šabanović, où il les a tués tous les deux à l’arme automatique, puis a mis le feu à la maison avec leurs corps.
Peković a également été reconnu coupable d’avoir violé le témoin blessé A1. À savoir, après qu’A1 a été amenée de force à Foča, dans la salle de sport du Partizan, Peković l’a emmenée hors de la salle avec son enfant mineur, avec le témoin A2 et plusieurs autres femmes et enfants. Il les a emmenés dans un appartement situé en face du poste de police, où A1 a été violée.
Pour expliquer ce verdict, la Cour a déclaré qu’il avait été prouvé au cours de la procédure, sur la base des déclarations de témoins, que le 8 juin 1992, Peković se trouvait dans le village de Hum, en compagnie d’autres membres de l’armée de la Republika Srpska. La Cour a particulièrement apprécié le témoignage de Ramiza Grcić, qui a vu des soldats serbes sortir Emina Šabanović de la maison, la frapper avec une pelle, la jeter sur des épines, la traîner par les cheveux et l’emmener inconsciente dans la maison de Mujo Šabanović. Au bout d’un certain temps, la maison fut incendiée et les corps d’Emina et de Mujo furent retrouvés carbonisés. Ramiza a déclaré qu’elle avait reconnu Peković parce qu’à un moment donné, il avait enlevé sa chaussette de sa tête et qu’elle le connaissait depuis longtemps.
En ce qui concerne la deuxième partie de l’acte d’accusation, la Cour a souligné que la déclaration de la partie lésée A1 était détaillée, tant en ce qui concerne le comportement de Peković envers elle qu’envers les autres femmes de l’appartement qui ont également été violées par d’autres soldats. Bien que A1 ne connaisse pas Peković, il a été identifié par le témoin A2, qui le connaissait déjà. Il a été établi que A1, A2 et les autres femmes ont été emmenées de la salle « Partizan » à un appartement près du poste de police, où Peković a violé A1. Les allégations de viol ont également été confirmées par des documents médicaux.
Ces faits ont également été établis par la Cour de Bosnie-Herzégovine lors de la condamnation de l’accusé Jasko Gazdić, ce qui a également été rappelé par la procureure spéciale Čolan Deretić lors de sa plaidoirie finale. Lors de la procédure menée à Sarajevo, le témoin a clairement accusé Gazdić et Ćurčić (Peković) de viol, et la Cour de BiH a accepté son témoignage comme étant crédible, détaillé et confirmé par des documents médicaux. À cette occasion, la Cour de BiH a déclaré, à l’appui de l’objectivité et de l’impartialité du témoignage de la partie lésée A1, qu’elle faisait une distinction claire dans les actions des accusés, déclarant que Slobodan Ćurčić (Peković) était grossier, bruyant et arrogant, tandis que Gazdić était silencieux et riait tout le temps.
Comme circonstances aggravantes, la Cour a considéré les condamnations antérieures de Peković, sa persistance et sa cruauté à commettre des infractions pénales, ainsi que sa ruse, compte tenu notamment du fait qu’il séjournait souvent dans le village de Hum et que les habitants le connaissaient, sans pour autant faire preuve de pitié à leur égard. La Cour n’a pas considéré le fait que Peković soit père de deux enfants comme une circonstance atténuante, déclarant qu’il n’avait fait preuve d’aucune compassion lors de la commission de l’infraction.
Le tribunal a renvoyé la partie lésée A1 à un procès civil pour faire valoir son droit de propriété. Cela expose maintenant la victime à une victimisation supplémentaire, car pour obtenir une indemnisation de Peković, elle doit engager une nouvelle procédure, révéler son identité et revivre le traumatisme, ce qui constitue une violation des normes de protection des victimes de violences sexuelles. Nous pensons que le tribunal devait statuer sur la demande d’indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure pénale, car il y avait le temps d’ordonner une expertise de son état psychophysique, étant donné les deux « étapes vides » au cours du procès qui a duré 19 mois sans audience.
Dalibor Tomović, l’avocat de la partie lésée, a déclaré : « Je pense qu’il s’agit d’un grand pas en avant, étant donné qu’il s’agit du premier cas de crime sexuel en temps de guerre au Monténégro. Étant donné que le procès en première instance a duré trois ans, et que 33 ans se sont écoulés depuis que le crime a été commis, j’espère qu’en cas d’appel de la défense, la Cour d’appel se prononcera en priorité. »
Ajna Mahmić, coordinatrice juridique du bureau international de TRIAL en Bosnie-Herzégovine : « Je pense que ce verdict est le résultat d’un travail commun, de longue haleine et dévoué des survivants et des organisations qui luttent pour que justice soit rendue aux victimes de crimes de guerre. Je voudrais exprimer une gratitude particulière à notre cliente, le témoin protégé – une femme courageuse qui, malgré des années de silence, de traumatisme et de peur, a décidé de s’exprimer et de demander justice. Sa détermination, sa dignité et sa force ont déclenché cette procédure et permis que le crime soit nommé, reconnu et sanctionné. Je remercie également sa famille pour le soutien qu’elle a apporté tout au long du processus – sans elle, ce moment n’aurait pas été possible. »
Tea Gorjanc Prelević, directrice exécutive de l’Action pour les droits de l’homme, Podgorica : « Le système judiciaire monténégrin a ainsi montré qu’il pouvait gérer des procès exigeants pour violences sexuelles dans lesquels les victimes sont des témoins protégés. J’attends de l’État qu’il veille à ce que les revendications patrimoniales de ces victimes soient tranchées dans le cadre de la procédure pénale et à ce que les victimes ne subissent pas de traumatismes supplémentaires. Ce verdict est important parce qu’il nous oblige à regarder en face les faits concernant la participation de citoyens monténégrins à des crimes de guerre de masse, et en particulier le viol de femmes en Bosnie-et-Herzégovine. J’appelle tous ceux qui savent quelque chose à ce sujet à contacter le bureau du procureur de l’État. Tous ces crimes ont laissé une marque permanente et douloureuse sur la vie de personnes innocentes et de leurs familles, en particulier les enfants.

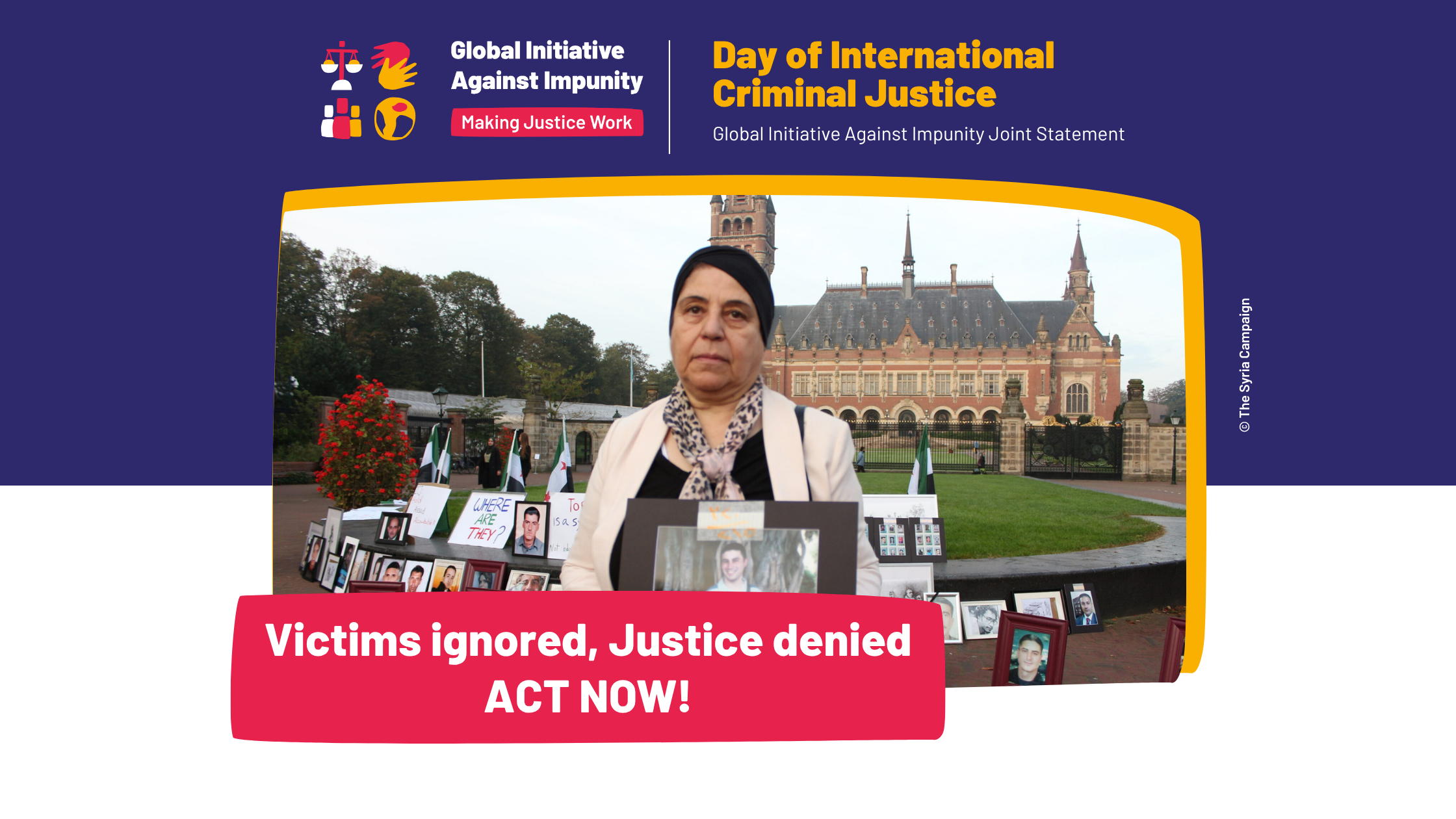
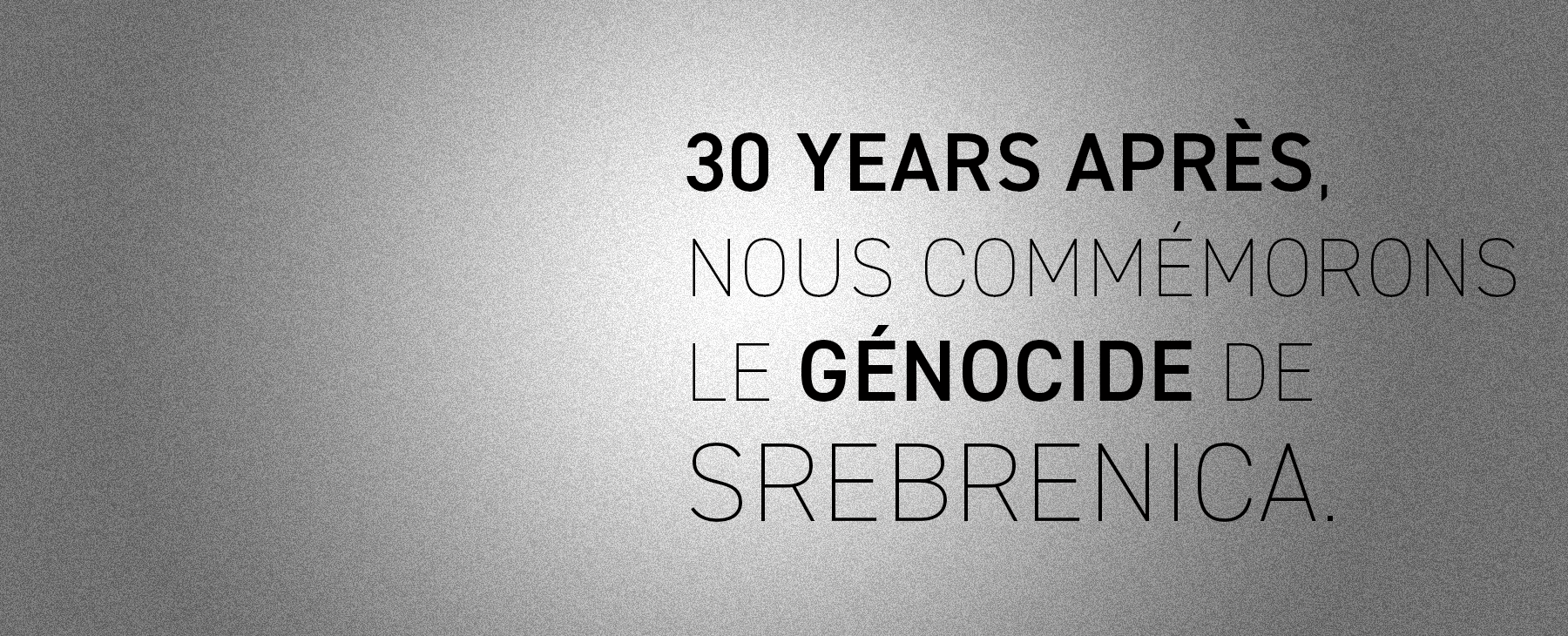






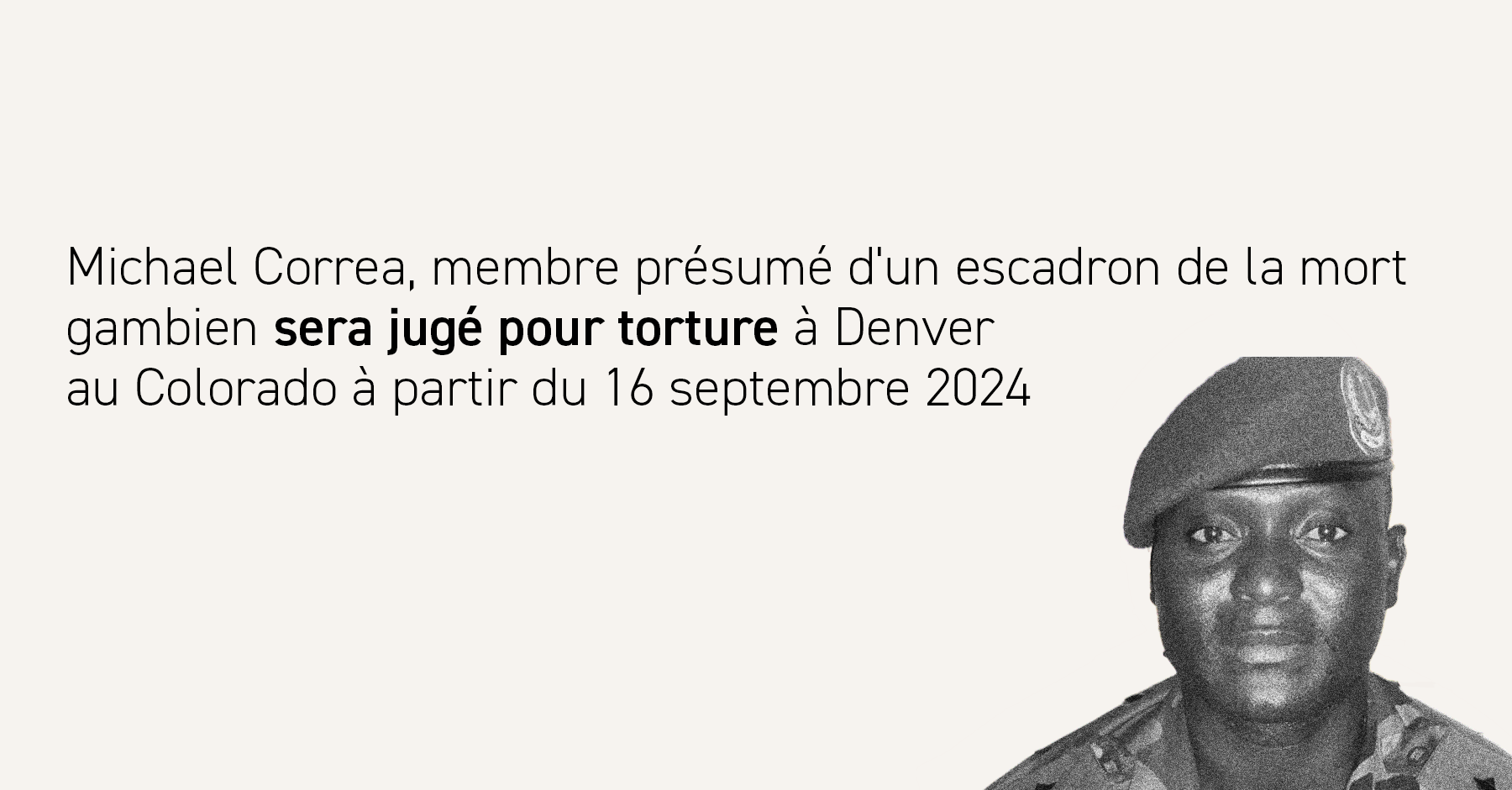


 Lancement du Centre de justice pour les droits de l’homme en janvier 2018, Katmandou – © Robic Upadhayay
Lancement du Centre de justice pour les droits de l’homme en janvier 2018, Katmandou – © Robic Upadhayay