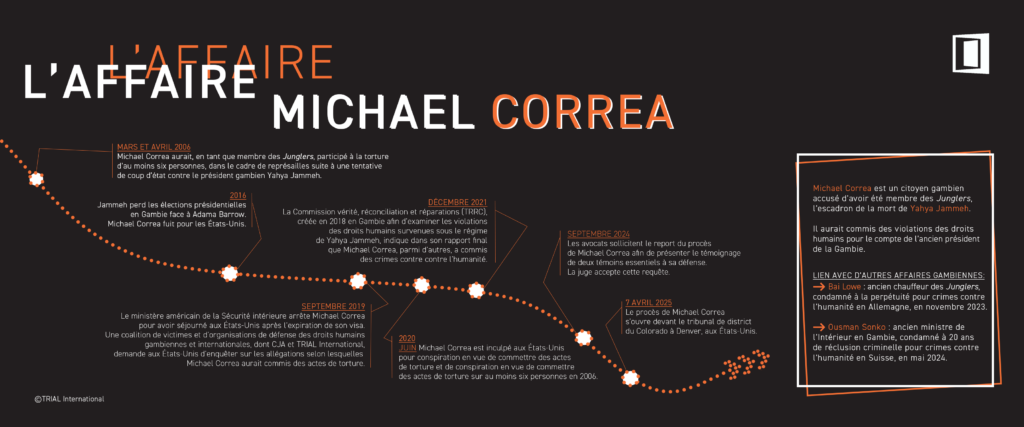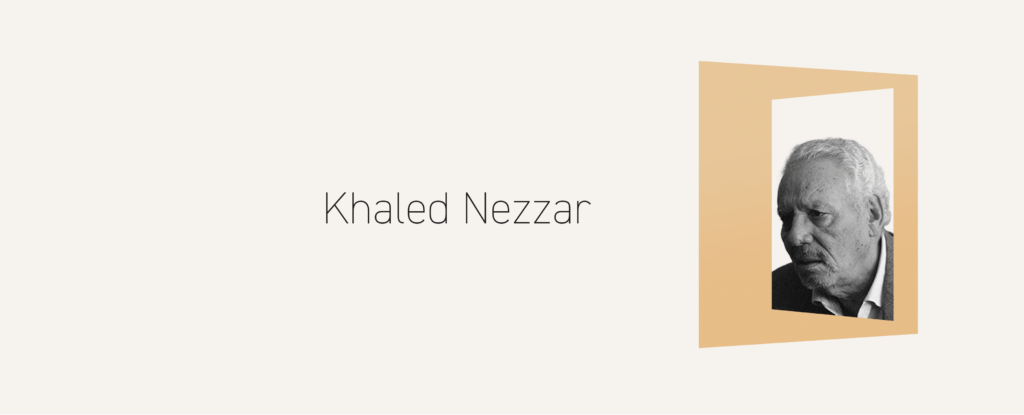Disparition forcée de Chakra Bahadur Katwal en décembre 2001
Histoire
En octobre 2010, TRIAL a déposé une plainte auprès du Comité des droits de l’homme des Nations unies au nom de Chakra Bahadur Katwal, victime de disparition forcée. Dans cette procédure, le Centre d’action juridique (CAJ) de TRIAL représente Yuba Katwal, épouse de Chakra Katwal. Ce dernier a disparu en décembre 2001 après avoir été arrêté et détenu par l’armée népalaise. Cette disparition s’inscrit dans un contexte d’état d’urgence décrété par le gouvernement népalais en novembre 2001.
Le 9 décembre 2001, alors qu’il se trouvait dans l’établissement dans lequel il enseignait, Chakra Katwal a reçu une lettre lui enjoignant de se rendre au Bureau de l’Education du district (situé à dans la ville d’Okhaldhunga, à une journée de marche de son village) afin de satisfaire à une demande de renseignements.
Arrivé à Okhaldunga quelques jours plus tard, Katwal s’est rendu auBureau de l’Education, où un employé lui aurait indiqué qu’il devait se présenter au poste de police du district pour répondre à un simple interrogatoire. De là, il aurait été emmené de force dans l’un des bâtiments de l’armée. Le lendemain, des témoins ont vu des soldats porter la victime par les bras et les jambes. Son corps était marqué de coups, ses vêtements étaient couverts de taches de sang et il semblait avoir perdu connaissance. La victime a été transportée dans les locaux du poste de police. Depuis ce jour, on ne l’a plus jamais revue.
Depuis sa disparition, son épouse n’a eu de cesse de rechercher la vérité auprès des autorités. Non seulement ses démarches sont restées vaines, mais elle a aussi été victime du harcèlement de l’armée népalaise et de mauvais traitements lors de son arrestation et de sa détention en 2005. Ces atroces mesures avaient pour but de la forcer à garder le silence sur l’implication de l’armée dans la disparition de son mari. Sa fille a également subi de graves sévices physiques et psychologiques pendant six semaines en 2005, alors qu’elle était détenue arbitrairement par l’armée. Suite à cela, elle a dû être hospitalisée. En dépit des soins médicaux prodigués, la jeune femme conserve à ce jour d’importantes séquelles.
L’affaire
En juillet 2006, les proches du disparu ont saisi la Cour suprême du Népal. Le 1er juin 2007, elle a confirmé que Chakra Katwal avait été arrêté et détenu arbitrairement par l’armée et la police népalaises, et que les mauvais traitements qu’il avait subis avaient entraîné sa mort. La Cour suprême a demandé que soient poursuivis pénalement les personnes impliquées dans cette affaire et dont les noms ont été cités dans le rapport d’enquête. Cependant, à ce jour, aucune suite n’a été donnée par les autorités de poursuites et l’impunité perdure. La famille de Katwal ignore par ailleurs toujours ce qu’il est advenu de son corps.
Le 27 octobre 2010, TRIAL a donc déposé pour le compte de Mme Katwal une requête auprès du Comité des droits de l’homme des Nations unies lui demandant de:
- Reconnaître que le Népal a violé de nombreux articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Népal a pourtant ratifié, suite à la disparition forcée de M. Katwal
- Requérir du Népal qu’il mène une enquête afin de localiser précisément l’endroit où a été enterré le corps de Chakra Katwal et de procéder à son exhumation afin que sa famille puisse organiser des funérailles selon ses traditions religieuses
- Demander au Népal de poursuivre pénalement les responsables de la disparition de Katwal
- Déclarer que le Népal a également violé le Pacte en raison des souffrances causées à la femme et à la famille de Katwal du fait de sa disparition
- Requérir du Népal qu’il accorde intégralement et dans les plus brefs délais une juste et adéquate compensation pour la souffrance et les pertes causées par la disparition de Katwal, et de prendre en charge les coûts de l’exhumation et de la cérémonie funéraire
- Demander au Népal de fournir les garanties nécessaires à la non répétition d’actes similaires à ceux dont a souffert Katwal ainsi que l’assurance que sa famille ne seront pas menacés durant la suite de la procédure.
La décision
En 2012, le Comité des droits de l’homme a déclaré la plainte admissible (en anglais), jugeant que l’épouse de Chakra Katwal avait épuisé tous les recours disponibles sans obtenir justice et réparation, et précisant qu’elle ne devait pas attendre la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle nationaux avant de renvoyer l’affaire devant le Comité. Selon ce dernier, les mécanismes de justice transitionnelle, comme les commissions de vérité, sont des outils importants pour établir la vérité, mais ne peuvent pas se substituer aux poursuites pénales.
Le 1er avril 2015, le Comité a adopté sa décision (en anglais). Il a déclaré le Népal responsable pour :
- avoir violé plusieurs dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et notamment le droit à la vie, à la reconnaissance de la personnalité juridique, à la liberté et l’interdiction de torture
- avoir privé de liberté, torturé, et fait disparaître Chakra Bahadur Katwal
- ne pas avoir mené d’enquête effective et ne pas avoir identifié, poursuivi et sanctionné les responsables
- avoir soumis l’épouse de la victime à un traitement inhumain et dégradant en n’établissant pas la vérité sur le sort de son époux et le lieu où il se trouve.
- Le Comité demande au Népal de:
- enquêter sur les fait, localiser et restituer à la famille la dépouille de M. Katwal
- identifier et traduire en justice les responsables sans plus attendre
- garantir que la femme de Chakra Katwal obtienne réparation, et notamment une indemnisation adéquate et des mesures de satisfaction
- Veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, notamment en assurant que la torture et la disparition forcée constituent des crimes au regard du droit pénal népalais.
Le Népal dispose maintenant de 180 jours pour informer le Comité des mesures prises pour donner effet à la décision.
Le contexte général
La disparition de Chakra Bahadur Katwal s’inscrit dans un contexte d’état d’urgence décrété par le gouvernement népalais en novembre 2001. L’Etat, qui a ainsi pu endurcir sa politique de répression à l’encontre des personnes suspectées d’aider les insurgés maoïstes, s’est arrogé le pouvoir de déroger au respect des droits et libertés fondamentaux. Le recours aux disparitions forcées, aux mauvais traitements, aux exécutions sommaires et aux détentions arbitraires perpétrées par les agents de l’Etat, mais aussi par les Maoïstes, s’est généralisé au cours de cette période.