Déclaration conjointe de la société civile
Le 20 mai 2020, le peuple burundais est appelé aux urnes pour une triple élection, présidentielle, législative et municipale. Les organisations burundaises et internationales expriment de fortes inquiétudes face à la multiplication d’actes de violence au cours de la campagne, qui constituent déjà des germes de contestation et d’escalade des troubles électoraux lors du scrutin.

Depuis le début de la campagne électorale, la société civile observe avec préoccupation la recrudescence des cas de violation des droits humains, des discours de haine ethnique, d’usage excessif de la force, des cas d’intolérance politique, des affrontements entre des membres des partis politiques, des intimidations et menaces à l’encontre des personnes assimilées ou membres de ces partis.
(…) Au cours des dernières semaines, le bilan en matière des droits humains est devenu très préoccupant. Des allégations de violations (…) font état d’au moins 22 personnes tuées, dont sept cas d’exécutions extrajudiciaires et 10 corps sans vie retrouvés, six personnes enlevées, deux victimes de violences sexuelles, 18 torturées et 67 arrêtées arbitrairement. (…) Parmi les victimes enregistrées figurent trois femmes et deux mineurs tués, deux mineurs enlevés, deux femmes torturées et quatre femmes arrêtées arbitrairement.
Un climat de peur, de provocation et de calomnie
Toutes ces violences sont accompagnées de nombreuses entraves et de blocages multiples lors des déplacements de certains candidats de l’opposition politique et à des interdictions d’organiser des rassemblements dans certaines localités ou enceintes. Un climat de peur, de provocation et de calomnie règne, ce qui risque de déboucher sur des confrontations plus grandes pendant et après le scrutin. Cette situation n’est pas de nature à préserver la paix et ramener la confiance entre les différents acteurs sociopolitiques.
(…) Les organisations signataires souhaitent rappeler aux autorités burundaises et aux différents partenaires internationaux du Burundi qu’une enquête a été ouverte par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale sur la situation qui prévaut dans le pays depuis 2015, notamment sur les violations des droits humains et du droit international humanitaire. Il est donc crucial que l’ensemble des parties prenantes consacre une attention particulière à toute dérive qui pourrait surgir au cours du scrutin à venir.
Signataires :
- TRIAL International
- Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)
- Collectif des associations contre l’impunité au Togo (CACIT)/Togo
- Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH)/ Côte d’Ivoire
- Observatoire des Femmes actives de Côte d’Ivoire (OFACI)/ Côte d’Ivoire
- Center for Human Rights and Democracy in Africa (CHRDA)/ Cameroun
- Alliance pour l’Universalité des Droits Fondamentaux (AUDF)/ RDC
- Réseau des Défenseurs des Droits de l’Homme (RDDH)/ RDC
- Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT/TCHAD)
- SOS Torture Burundi/ Burundi
- Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-Burundi)
- Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes de Crimes de Droit International commis au Burundi (CAVIB)/ Burundi













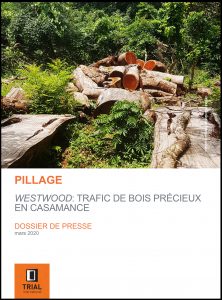



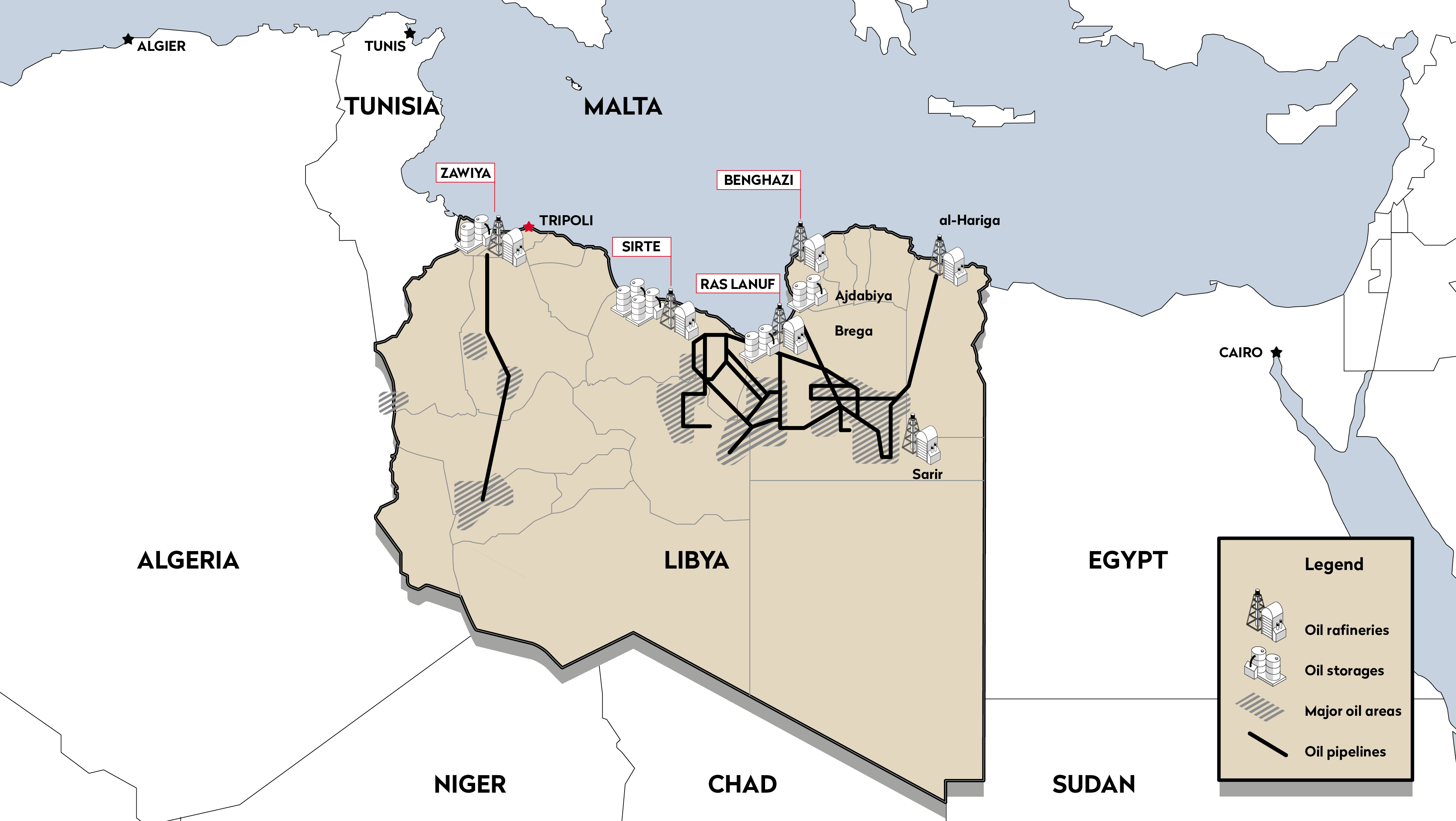
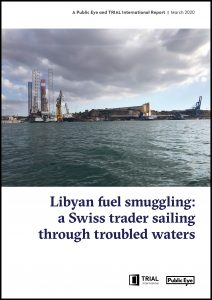 Lire le rapport complet (en anglais)
Lire le rapport complet (en anglais)