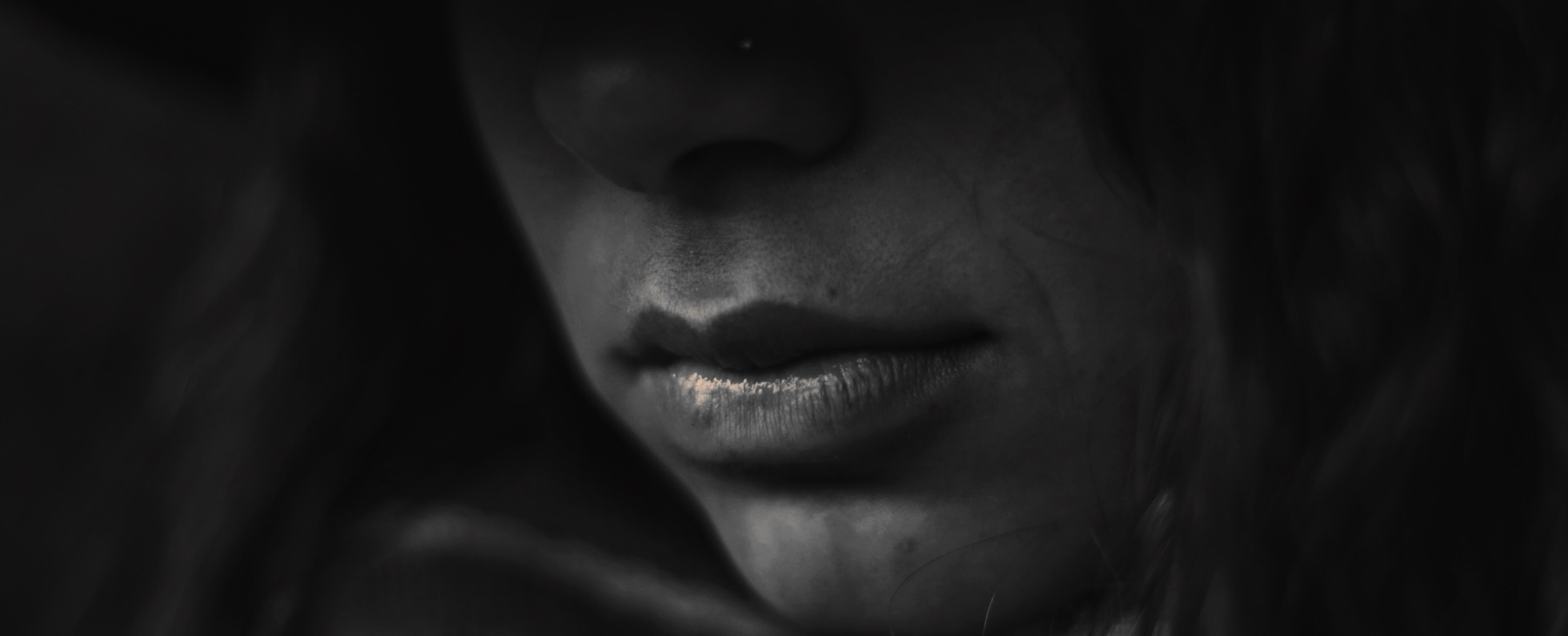Genève, 10 mars 2021. Le premier procès porté par TRIAL International s’ouvre aujourd’hui au Kasaï-central (République démocratique du Congo). Dans une région régulièrement citée comme une zone de non-droit, où l’impunité est la norme, cette affaire contre deux miliciens accusés de crimes internationaux envoie un message clair : la route est encore longue, mais la justice peut triompher.

Au printemps 2017, plusieurs villages dans le territoire de Kazumba (Kasaï-central) ont été attaqués par une milice liée à l’insurrection armée de Kamuina Nsapu. Meurtres, pillages et tortures ont été commis contre des centaines de civils, en représailles à leur refus de collaborer avec ce groupe armé. Le commandant de celui-ci, Nsumbu Katende, est aujourd’hui jugé pour crimes de guerre et de terrorisme. Un autre milicien sous ses ordres est également sur le banc des accusés.
« Nous devons sortir de la vision fataliste que les violences au Kasaï sont vouées à rester impunies » déclare Guy Mushiata, Coordinateur national de TRIAL International en République démocratique du Congo (RDC). « La justice congolaise a déjà prouvé dans d’autres provinces que les seigneurs de guerre ne sont pas au-dessus des lois. C’est aujourd’hui au Kasaï que nous voulons faire changer les mentalités et contribuer à rétablir l’état de droit. »
Le Kasaï, tristement célèbre pour ses crimes de masse
Située au sud de la RDC, la région du Kasaï est tristement célèbre pour le violent conflit qui a opposé de 2016 à 2019 l’insurrection armée de Kamuina Nsapu et le gouvernement de Kinshasa. La population civile, prise en étau entre les innombrables factions armées, a subi des crimes de masse, dont la plupart sont encore impunis. En mars 2017, le Kasaï a fait les Unes du monde entier quand deux experts des Nations Unies, l’Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, ainsi que les quatre Congolais qui les accompagnaient, ont été enlevés et tués.
Le procès qui s’ouvre aujourd’hui est indirectement lié à ces crimes, puisque le commandant Nsumbu Katende et son acolyte ont opéré dans le même mouvement insurrectionnel que les individus accusés d’avoir tué Michael Sharp et de Zaida Catalan : le Kamuina Nsapu. Les crimes jugés ont d’ailleurs eu lieu deux semaines avant l’enlèvement des deux experts. Si le procès ne prétend pas faire la lumière sur ces meurtres en particulier – qui font l’objet d’un autre procès en cours – l’affaire ébranle sérieusement l’impunité des milices armées et pourrait ouvrir la porte à d’autres poursuites.
Une évolution rapide après des années de stagnation
Ce procès s’ouvre à peine plus d’un an après que TRIAL International a ouvert son premier projet au Kasaï. C’est lors d’échanges avec les acteurs locaux que l’affaire a été portée à l’attention de l’organisation. En septembre 2020, TRIAL International a facilité une mission de documentation, pendant laquelle près de 300 victimes ont été identifiées. Grâce à ce complément d’enquête, le Procureur a considéré les preuves suffisantes pour clôturer son enquête et saisir le tribunal militaire de garnison de Kananga.
« Nous sommes ravis de cette évolution rapide du dossier », se réjouit Daniele Perissi, Responsable du programme Grands Lacs. « Elle s’explique par l’excellente collaboration entre les autorités judiciaires du Kasaï-central et ses partenaires locaux et internationaux. » Et prouve aux sceptiques que même dans les régions les plus affectées, l’impunité des crimes de masse peut être combattue.
TRIAL International collabore au Kasaï-central avec Physicians for Human Rights, une ONG qui utilise la preuve médicale pour documenter les violations des droits humains. Leur projet conjoint au Kasaï vise à renforcer l’accès à la justice en combinant leurs expertises juridique et médical. Ce projet bénéficie du généreux soutien de l’Agence suédoise de coopération pour le développement international, Sida.